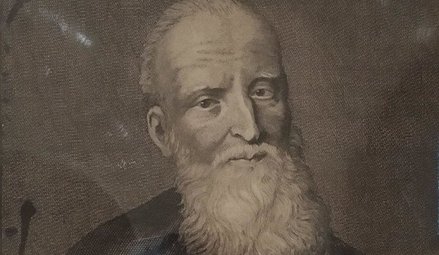- Accueil
- Toutes les raisons
- Par thème
- Jésus
- Il y a de multiples preuves de la Résurrection du Christ
- Le Christ a donné toutes les preuves divines qui convenaient (cf. SCLG n°6)
- La sublimité de la Parole du Christ
- Le trilemme de Lewis : une preuve de la divinité de Jésus
- L'autorité divine du Christ, dont le seul nom chasse les démons
- Dieu sauve : la puissance du saint nom de Jésus
- Jésus, l'homme qui parlait et agissait comme l'égal de Dieu
- La vérité de Jésus transparaît même dans le Coran
- La grandeur sublime de la Passion du Christ
- Le seul homme dont on témoigne au prix de la vie qu'il est ressuscité des morts
- Jésus est venu au meilleur moment pour façonner l’histoire de l’humanité
- Les sources rabbiniques rendent témoignage aux miracles de Jésus
- Marie
- L'Eglise
- La propagation miraculeuse du Christianisme
- La conversion de l’Empire romain au christianisme (392)
- L'Eglise catholique et son magistère existent depuis près de 2000 ans
- Le Magistère infaillible de l'Eglise
- Le concept de Révélation suppose le concept de Magistère
- Le trésor de la doctrine sociale de l'Eglise
- Humane Vitae, un argument frappant en faveur du catholicisme (1968)
- La Bible
- Les auteurs des Évangiles sont des témoins oculaires ou de proches associés
- L’onomastique est en faveur de la fiabilité historique des Évangiles
- Le Nouveau Testament n’a pas été corrompu
- Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l’Antiquité
- Les Évangiles ont été écrits trop tôt pour être des légendes
- Le Nouveau Testament est fiable, c’est l’archéologie qui le dit
- Le critère d’embarras prouve que les Évangiles ne peuvent pas être un mensonge
- Le critère de dissimilarité renforce la fiabilité des Évangiles
- 84 détails du livre des Actes des apôtres sont confirmés par l’histoire et l’archéologie
- D'extraordinaires prophéties annonçaient la venue du Messie
- Le temps de la venue du Messie a aussi été précisément prophétisé
- La peinture ultraréaliste des tortures du Messie par le prophète Isaïe
- Le prophète Daniel a annoncé un « fils d’homme » qui est le portrait du Christ
- Rapidité et fiabilité de la genèse des Evangiles
- Les Apôtres
- Saint Pierre, chef des apôtres (+64)
- Saint André (+45)
- Saint Jacques le Majeur, premier apôtre martyr (+41)
- Saint Jean l’évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu (+100)
- Saint Philippe (+85)
- Saint Barthélémy (+47)
- Saint Thomas, "jumeau du Christ" (+72)
- Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr (+61)
- Jacques le Juste, « frère » du Christ, apôtre et martyr (+62)
- Saint Jude Thaddée (+65)
- Saint Simon le Zélote (+60)
- Saint Matthias (+63)
- Les martyrs
- Saint Jean-Baptiste (+29)
- Saint Étienne, premier des martyrs (+31)
- Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple de Jean et martyr (+155)
- Sainte Blandine et les Martyrs de Lyon, la force de la foi (+177)
- Sainte Cécile (+230)
- Sainte Agathe (+251)
- Sainte Agnès (+304)
- Sainte Lucie de Syracuse, vierge et martyre pour Jésus-Christ (+304)
- Sainte Julienne de Nicomédie (IVème siècle)
- Thomas More, « bon serviteur du roi, et de Dieu en premier » (+1535)
- Le martyre de Paul Miki et de ses compagnons (+1597)
- « C’est lui que j’aime et je suis prête à mourir pour lui » : la néo-martyre Kyranna (+1751)
- Les martyrs d’Angers et d’Avrillé (+1794)
- Les seize Carmélites martyres (+1794)
- Le père Dung Lac et ses 116 compagnons martyrs au Vietnam (XVIIe - XIXe)
- Il brave les supplices pour expier son apostasie (+1818)
- Blaise Marmoiton, l'épopée d'un missionnaire au bout du monde (+1847)
- Double peine pour le père Chapdelaine (+1856)
- Mort à 14 ans pour le Christ Roi, José Luis Sanchez del Rio (+1928)
- Saint Maximilien Kolbe, le chevalier de l’Immaculée (+1941)
- Les moines de Tibhirine (+1996)
- Les moines
- Les Pères du désert (IIIe siècle)
- Saint Antoine du désert, le « père des moines » (+356)
- Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (+550)
- Le Mont Athos (Xème siècle)
- Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée (+1101)
- Le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, carme couronné de fleurs (+1438)
- Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie (+1841)
- Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers un humble frère qui prie (+1968)
- La mort étonnante du père Emmanuel de Floris (+1992)
- Les prophéties du père Païssios, du mont Athos (+1994)
- Les saints
- Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie (-19)
- Saint Nazaire, apôtre et martyre (+68 ou 70)
- Ignace d’Antioche : successeur des apôtres et témoin de l’Évangile (+117)
- Saint Grégoire le Thaumaturge (+270)
- Saint Martin de Tours, père de la France chrétienne (+397)
- Saint Loup, l’évêque qui fit rebrousser chemin à Attila (+623)
- Saint Dominique de Guzman, athlète de la foi (+1221)
- Saint François, le pauvre d’Assise (+1226)
- Saint Antoine de Padoue, le « saint que tout le monde aime » (+1231)
- Sainte Rose de Viterbe : comment la prière change le monde (+1252)
- Saint Simon Stock reçoit le scapulaire du Mont Carmel (+1265)
- Saint Albert le Grand, les noces de l'intelligence et de la foi (+1280)
- L’étrange barque de saint Basile de Riazan (+1295)
- L’absolue confiance en Dieu de sainte Agnès de Montepulciano (+1317)
- L’extraordinaire conversion de Micheline de Pesaro (+1356)
- Saint Pierre Thomas : une confiance en la Vierge Marie à toute épreuve (+1366)
- Sainte Rita de Cascia, celle qui espère contre toute espérance (+1457)
- Sainte Catherine de Gênes, ou le feu de l’amour de Dieu (+1510)
- Saint Antoine-Marie Zaccaria, médecin des corps et des âmes (+ 1539)
- Saint Ignace de Loyola : à la plus grande gloire de Dieu (+1556)
- Saint Pascal Baylon, la gloire mondiale d’un humble berger (+1592)
- Alphonse Rodriguez, le saint portier jésuite (+1617)
- Martin de Porrès revient hâter sa béatification (+1639)
- Virginia Centurione Bracelli : quand toutes les difficultés s’aplanissent (+1651)
- Sainte Marie de l’Incarnation, « la sainte Thérèse du Nouveau Monde » (+1672)
- Lorsque le moine Seraphim contemple le Saint-Esprit (+1833)
- Saint Jean-Marie Vianney, la gloire mondiale d'un petit curé de campagne (+1859)
- Gabriel de l’Addolorata, le « jardinier de la Sainte Vierge » (+1862)
- À Grenoble, le « saint abbé Gerin » (+1863)
- Antoine-Marie Claret, un tisserand devenu ambassadeur du Christ (+1870)
- Bienheureux Francisco Palau y Quer, un amoureux de l’Église (+1872)
- Les saints époux Louis et Zélie Martin (+1894)
- La maturité surnaturelle de Francisco Marto, « consolateur de Dieu » (+1919)
- Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde (+1938)
- Frère Marcel Van, une « étoile s’est levée en Orient » (+1959)
- Les docteurs
- Les mystiques
- Sainte Marguerite-Marie voit le « Cœur qui a tant aimé les hommes » (1673-1689)
- Sainte Lutgarde et la dévotion au Sacré Cœur (+1246)
- Sainte Angèle de Foligno et « dame pauvreté » (+1309)
- Sainte Thérèse d'Avila (+1582)
- Saint Jean de la Croix, poète et psychologue universel (+1591)
- Bienheureuse Anne de Jésus, carmélite aux dons mystiques (+1621)
- Catherine Daniélou, témoin du Christ en Bretagne (+1667)
- Les prédictions de sœur Yvonne-Aimée concernant la Seconde Guerre mondiale (1922)
- Sœur Josefa Menendez, apôtre de la miséricorde divine (+1923)
- Édith Royer et le Sacré-Cœur de Montmartre (+1924)
- Rozalia Celak, une mystique à la mission très spéciale (+1944)
- Rolande Lefevre (+2000)
- Les visionnaires
- Sainte Perpétue délivre son frère du purgatoire (203)
- Anne-Catherine Emmerich
- Marie d’Agreda retranscrit la vie de la Vierge Marie (+1665)
- La découverte de la maison de la Vierge Marie à Éphèse (1891)
- Sœur Benigna Consolata, la « petite secrétaire de l’amour miséricordieux » (+1916)
- Quand les visions de Maria Valtorta coïncident avec les observations de l’Institut météorologique d’Israël (1943)
- Berthe Petit et ses prophéties relatives aux deux guerres mondiales (+1943)
- Maria Valtorta ne voit qu’une seule des pyramides de Gizeh… et à raison ! (1944)
- Les 700 extraordinaires visions de l’Évangile reçues par Maria Valtorta (+1961)
- L’étonnante exactitude géologique des écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Les observations astronomiques des écrits de Maria Valtorta confirmées (+1961)
- Découverte anticipée par vision mystique d’une maison princière à Jérusalem (+1961)
- Les tours de Jezreel dans les écrits de Maria Valtorta (+1961)
- Les papes
- Les grands témoins de la foi
- La conversion de saint Augustin : « Combien de temps remettrai-je à demain ? » (386)
- Tommaso de Vio, dit Cajétan, une vie au service de la vérité (+1534)
- Madame Acarie ou le « livre vivant de l’amour de Dieu » (+1618)
- Pascal et la révélation des prophètes (+1662)
- À 10 ans, elle souffre et meurt pour sauver les âmes de l’enfer (+1920)
- Le père Jean-Édouard Lamy, un « second curé d’Ars » (+1931)
- l'Abbé Georges Lemaître
- La civilisation chrétienne
- La profondeur de la spiritualité chrétienne
- Cohérence et force de la vie mystique chez Jean de la Croix
- Le dogme de la Trinité : une vérité de mieux en mieux comprise
- L’incohérence des critiques contre le christianisme
- L’Esprit Saint se manifeste de nos jours comme en une « nouvelle Pentecôte »
- La foi chrétienne explique la diversité des religions
- L'imitation de Jésus-Christ
- Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
- Le Cardinal Pierre de Bérulle, « apôtre du Verbe incarné » (+1629)
- La théologie du corps de saint Jean-Paul II
- Les interventions du Christ dans l'Histoire
- Les apparitions et interventions mariales
- Notre-Dame du Pilar à Saragosse (40)
- Le Puy-en-Velay (431)
- Une source à l'origine d'une multitude de miracles à Constantinople (457)
- Notre Dame des Vertus sauve la ville de Rennes (1357)
- Marie fait arrêter l’épidémie de peste au mont Berico (1426)
- Cotignac, premières apparitions modernes de l'histoire (1519)
- Guadalupe (1531)
- Savone : la naissance d’un sanctuaire (1536)
- La Vierge Marie délivre les chrétiens de la cité de Cuzco au Pérou (1536)
- La victoire de Lépante et la fête de Notre-Dame du Rosaire (1571)
- Les apparitions au frère Fiacre (1637)
- Le « vœu des échevins », ou la dévotion mariale des Lyonnais (1643)
- Notre Dame de Nazareth à Plancoët (1644)
- La Madone de Laghet (1652)
- Les apparitions de saint Joseph au Bessillon (1661)
- Les confidences du Ciel à la bergère du Laus (1664-1718)
- Zeitoun, un miracle de deux années (1968-1970)
- Le Saint Nom de Marie et la victoire décisive de Vienne (1683)
- Le ciel touche la terre en Colombie : Las Lajas (1754)
- La Vierge apparaît et prophétise en Ukraine depuis le XIXe siècle (1806)
- Les apparitions de la Vierge à Catherine Labouré au 140 rue du Bac à Paris (1830)
- « Consacre ta paroisse au cœur immaculée de Marie » (1836)
- A la Salette, Marie pleure près des bergers (1846)
- Bernadette Soubirous, bergère qui vit la Vierge (1858)
- La Vierge Marie dans le Wisconsin : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (1859)
- Pontmain (1871)
- « Je suis toute miséricordieuse » : Notre Dame à Pellevoisin (1876)
- Les apparitions de Gietrzwald, un secours extraordinaire en Pologne (1877)
- L'apparition silencieuse de Knock Mhuire en Irlande (1879)
- Marie « Mère abandonnée » apparaît dans un quartier populaire de Lyon (1882)
- Les trente-trois apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (1932)
- La « Vierge des pauvres » apparaît à huit reprises à Banneux (1933)
- La Rosa Mystica de Montichiari (1947)
- Marie répond au vœu des Polonais (1956)
- Ils sont des centaines de milliers à avoir vu la Vierge à Zeitoun en Égypte (1968)
- « Une Belle Dame » vient au secours de la France à l'Ile Bouchard (1947)
- Maria Esperanza et Notre-Dame Réconciliatrice des Peuples de Bétania (1976)
- Luz Amparo et les apparitions de l’Escorial en Espagne (1981)
- Les extraordinaires apparitions de Medjugorje et leur impact mondial (1981)
- La Vierge Marie prophétise les massacres au Rwanda (1981)
- Apparitions et message de la Vierge Marie à Myrna (1982)
- La Vierge Marie guérit un adolescent, avant de lui apparaître à Belpasso (1986)
- Seuca : l’appel de la « Reine de lumière » en Roumanie (1995)
- Les anges et leurs manifestations
- Le Mont Gargano
- Le Mont Saint-Michel, ou comment le ciel veille sur la France
- Des anges donnent une ceinture surnaturelle au chaste Thomas d’Aquin (1243)
- Françoise Romaine, le jeu du Ciel et de l’enfer (+1440)
- L’ange qui fait évader Mère Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)
- Le sauvetage angélique des accidentés de l’autoroute 6 (2008)
- Les exorcismes au nom du Christ
- Une vague de charité unique au monde
- D'innombrables œuvres d'éducation
- D'innombrables œuvres de charité
- Saint Martin de Tours
- Sainte Angèle Mérici : pour servir, non être servie (+1540)
- Saint Jean de Dieu, ou Jésus au service des malades (+1550)
- Saint Camille de Lellis, réformateur des soins hospitaliers (vers 1560)
- Bienheureuse Alix Le Clerc, encouragée par Marie à créer des écoles (+1622)
- Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (+1660)
- Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Montréal (+1700)
- Takashi Nagai
- Frédéric Ozanam, inventeur de la doctrine sociale de l’Église (+1853)
- Damien de Molokai, missionnaire lépreux (+1889)
- Pier Giorgio Frassati, la charité héroïque (+1925)
- Sœur Dulce, le « bon ange de Bahia » (+1992)
- Mère Teresa de Calcutta, une foi inébranlable (+1997)
- Heidi Baker : l’amour de Dieu au cœur des ténèbres
- Des miracles étonnants
- Le Linceul de Turin, témoin de la Passion et de la Résurrection du Christ
- Le Saint Feu de Jérusalem
- Le miracle de la liquéfaction du sang de saint Janvier (431)
- Les miracles de saint Antoine de Padoue (+1231)
- La Tilma de Guadalupe (1531)
- Saint Pie V et le miracle du crucifix (1565)
- Saint Philippe Néri ressuscite un jeune mort (1583)
- La résurrection de Jérôme Genin (1623)
- Saint François de Sales ressuscite une enfant noyée (1623)
- Saint Jean Bosco et la promesse d’outre-tombe (1839)
- Le jour où le soleil dansa (1917)
- Pie XII et le miracle du soleil au Vatican (1950)
- L'escalier de saint Joseph à Santa Fe
- Le sauvetage miraculeux de Charle par Charles (2016)
- Reinhard Bonnke : 89 millions de conversions (+2019)
- Guérisons miraculeuses
- Le toucher des écrouelles : un miracle de guérison pluriséculaire (XIe-XIXe)
- Avec plus de 7500 dossiers de guérisons inexpliquées, Lourdes est unique au monde (1858)
- Mariam, le « petit rien de Jésus » : une sainte de l'Orient à l'Occident (+1878)
- Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf (+1898)
- Gemma, guérie afin d’expier les fautes des pêcheurs (+1903)
- La guérison de Sœur Marie-Joséphine Catanea (+1948)
- La guérison extraordinaire d’Alice Benlian en l’église Sainte-Croix de Damas (1983)
- Le miracle de béatification de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)
- « Pour que le monde croie, tes plaies s’ouvriront tous les 22 du mois » (1993)
- Le miracle qui a conduit frère André sur les autels (1999)
- La repousse de l’intestin de Bruce Van Natta : un miracle irréfutable (2007)
- Manouchak, opérée par saint Charbel (2016)
- Le cancer de Maya, guérie sur le tombeau de saint Charbel (2018)
- Père Emiliano Tardif
- Damian Stayne
- Corps conservés des saints
- Mourir en odeur de sainteté
- Le corps de sainte Cécile, retrouvé intact (+230)
- Stanislas Kostka brûle d’amour pour Dieu (+1568)
- Bienheureux Antonio Franco, l’évêque défenseur des pauvres (+1626)
- Le corps incorrompu de Marie-Louise Nerbolliers, la visionnaire de Diémoz (+ 1910)
- La grande exhumation de saint Charbel (1950)
- Bilocations
- Inédies
- Lévitations
- Lacrimations et images miraculeuses
- Stigmates
- Tout un couvent tiré vers le Ciel avec la vénérable Lukarde d’Oberweimar (+1309)
- La bienheureuse Maria Grazia Tarallo, stigmatisée et mystique extraordinaire (+ 1912)
- Saint Padre Pio, « crucifié d’amour » (1918)
- Hélène Aiello, une « âme eucharistique » (+1961)
- Un triduum au côté de Jésus souffrant (1987)
- Un Jeudi saint à Soufanieh (2004)
- Miracles eucharistiques
- Reliques
- Le voile de Véronique, dit voile de Manoppello
- Le Linceul de Turin a été pendant des siècles la seule image en négatif au monde
- L'exceptionnelle histoire de la Tunique d'Argenteuil (30)
- Saint Louis et les attributs de la Passion (+1270)
- Le sauvetage miraculeux du Linceul de Turin (1997)
- Étude comparative des sangs des reliques du Christ
- Des juifs découvrent le Messie
- Saint Paul
- David Paul Drach
- François-Xavier Samson Libermann, israélite converti à la foi en Jésus-Christ (1824)
- Le rendez-vous mystique d’Alphonse Ratisbonne (1842)
- Eugenio Zolli
- Max Jacob : conversion inattendue d’un artiste libertin (1909)
- Edith Stein « unie au Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une juive » (1921)
- Un juif découvre le Messie à la suite de la guérison miraculeuse de sa mère : Patrick Elcabache (1958)
- Aron Jean-Marie Lustiger, un choix de Dieu (+2007)
- Roy Schoeman
- Conversions de musulmans
- Nicolas Nazzour (Soufanieh, après 1981)
- Il a rencontré Jésus en cherchant Muhammad (1990)
- Le chemin de Selma vers le baptême (1996)
- Soumia, sauvée par Jésus en entendant les cantiques de Noël (2003)
- Comment le Christ s’est révélé dans la vie d’Aïsha (2004)
- Amir choisit le Christ, même au risque de dormir dans la rue (2004)
- La « course-poursuite » de Khadija avec Dieu (2023)
- Conversions de bouddhistes
- Conversions d'athées
- La conversion inespérée d’un bourreau de la Terreur (1830)
- Saint Charles de Foucauld (1886)
- La conversion de Paul Claudel : un grand poète bouleversé pour la vie (1886)
- Madeleine Delbrêl, éblouie par Dieu (1924)
- C.S. Lewis, converti malgré lui (1931)
- Le jour où André Frossard a rencontré le Christ à Paris (1935)
- Un rappeur de MC Solaar converti par la Passion du Christ
- Le père Sébastien Brière, converti à Medjugorje (2003)
- Franca Sozzani, la « papesse de la mode » qui voulait rencontrer le pape (2016)
- Nelly Gillant, du monde des morts à la foi catholique (2018)
- Témoignages de rencontres avec le Christ
- Les expériences de mort imminente (EMI) confirment la doctrine sur les fins dernières
- L’EMI de sainte Christine l’Admirable, source de conversion au Christ (1170)
- Jésus parle à Alphonse de Liguori qui, en retour, promet d’entrer dans les ordres (1723)
- Bienheureuse Dina Bélanger : aimer et laisser faire Jésus et Marie (+1929)
- Gabrielle Bossis, « Lui et moi » (+1950)
- La conversion d'André Levet en prison (1969)
- Voyage entre paradis et enfer, une « expérience de mort imminente » (1971)
- Alice Lenczewska : dialogues avec Jésus (1985)
- Vassula et La Vraie Vie en Dieu (1985)
- Nahed Mahmoud Metwalli, de persécutrice à persécutée (1987)
- Le verset de la Bible qui a converti Élie (2000)
- Chantal, invitée à la cour céleste (2017)
- Histoires providentielles
- Sainte Agathe sauve la ville de Catane de la lave (252)
- L’intuition surhumaine de saint Pacôme le Grand (+346)
- Les prédictions et protections de Germain d’Auxerre pour sainte Geneviève (446)
- Il doute de la Providence : Dieu lui envoie sept étoiles pour éclairer sa route (1132)
- La réconciliation surnaturelle du duc d’Aquitaine (1134)
- Zita et le miracle du manteau (XIIIe)
- Jeanne d’Arc, la plus belle histoire du monde (+1431)
- Jean de Capistran sauve l’Église et l’Europe (1456)
- Une musique céleste réconforte Elisabetta Picenardi sur son lit de mort (+1468)
- Et une grande lumière ouvrit la porte de son cachot… (1520)
- L’étrange aventure d’Yves Nicolazic (1623)
- Julien Maunoir apprend miraculeusement le breton (1626)
- Pierre de Keriolet : avec Marie, nul ne se perd (1636)
- La conversion autonome de la Corée (XVIIIe)
- Le poème prophétique qui annonçait Jean-Paul II (1840)
- Grigio, l’étrange chien de Don Bosco (1854)
- Thérèse de Lisieux, protectrice de ceux qui combattent (1914-1918)
- Perdue pendant plus d’un siècle, une icône russe réapparaît (1930)
- En 1947, une croisade du rosaire libère l’Autriche des Soviétiques (1946-1955)
- La découverte du tombeau de saint Pierre à Rome (1949)
- Il était censé mourir de froid dans les geôles soviétiques (1972)
- Un agent secret protégé par Dieu (1975)
- La lave s’arrête aux portes de l’église (1977)
- Une main protectrice sauve Jean-Paul II avec des répercussions providentielles (1981)
- Marie qui défait les nœuds : le cadeau du pape François au monde (1986)
- La découverte de Notre-Dame de France par Edmond Fricoteaux (1988)
- Un évêque vietnamien tiré de prison par Marie (1988)
- La chute du communisme (1989)
- Les miracles de sainte Julienne (1994)
- Le lancement des « Vierges pèlerines » dans le monde a été permis par la Providence de Dieu (1996)
- Un couvent miraculeusement protégé de tous les maux (2011-2020)
- Jésus
- Qui sommes-nous ?
- Conférences
- Chaîne Youtube
- Faire un don
- S'abonner au magazine
TOUTES LES RAISONS DE CROIRE
Les apparitions et interventions mariales
n°28
Gietrzwald (Pologne)
Du 27 juin au 16 septembre 1877
Les apparitions de Gietrzwald en secours à une minorité persécutée
En 1871, la Prusse protestante entame une politique discriminatoire à l’encontre des catholiques (le Kulturkampf de Bismarck), notamment au sein des territoires annexés de Pologne. C’est dans ce climat politique tendu que se déroulent les apparitions de Gietrzwald : entre juin et septembre 1877, la Vierge Marie apparaît 160 fois à deux jeunes filles polonaises et invite à prier pour que cessent les persécutions contre les catholiques. Les apparitions ont porté immédiatement d’admirables fruits humains et spirituels dans toute la région (foi, paix et guérisons).

Basilique de la Nativité de la Vierge Marie à Gietrzwałd / © CC BY-SA 4.0/Mazaki
Les raisons d'y croire :
- L’enquête officielle débute avant même la fin des apparitions. Les trois médecins (deux catholiques et un protestant) ayant examiné les voyantes sont unanimes : leur santé physique et mentale est parfaite. De plus, ils ont observé chez elles des changements physiologiques au moment des apparitions qu’il serait impossible de simuler.
- L’objectif d’une supercherie de cet ordre serait difficile à comprendre : confesser la foi catholique était alors passible de sérieux tracas et de poursuites. L’hypothèse d’une escroquerie est très peu crédible.
- L’Église catholique fait preuve d’énormément de prudence vis-à-vis des phénomènes soi-disant inexpliqués. L’enquête se conclut pourtant très favorablement et l’origine surnaturelle des apparitions sera par la suite reconnue par l’Église.
- L’occupant prussien fit tout pour mettre un terme à l’événement : en vain. Malgré l’hostilité du régime communiste polonais au XXe siècle, le nombre de pèlerins n’a pas diminué.
Synthèse :
Gietrzwald, 1877. Ce village de 2000 âmes appartient à la région de Warmie-Mazurie, située dans le nord-est de la Pologne actuelle, traditionnellement catholique, mais annexée à la Prusse protestante depuis près d’un siècle. La décennie 1870-1880 marque un temps de vexation et de discrimination systématique de la part du chancelier Bismarck à l’encontre des catholiques polonais, dans le cadre de sa politique du Kulturkampf (« combat pour la civilisation ») : incarcération d’évêques et de prêtres, expulsion des congrégations religieuses, interdiction de la langue polonaise dans les écoles et dans les administrations depuis 1873, etc.
Néanmoins, la foi des habitants demeure intacte et la vie spirituelle continue de plus belle. Les familles des deux voyantes de Gietrzwald en sont de beaux exemples : fidèles à l’Église, unies, aimantes et ouvertes à la souffrance d’autrui, y compris celle des protestants. La dévotion mariale y est forte depuis plusieurs siècles.
Le 27 juin 1877, Justyna Szafrinska, 13 ans, orpheline de père, employée dans une exploitation de volailles pour aider sa famille démunie, que rien ne distingue de ses camarades de jeu, rentre du presbytère où le curé du village l’a reçue avec sa mère, dans le cadre de la préparation à sa communion. À peine sorties du bâtiment, Justyna et sa mère se mettent à prier à une centaine de mètres d’un érable : l’angélus vient de sonner. Soudain, la jeune fille lève les yeux en direction de l’arbre où elle aperçoit quelque chose d’anormal qui l’attire : une « lumière blanche » qui « grandit », laissant bientôt apparaître en son centre une « silhouette humaine », une femme d’une grande beauté, accompagnée par un « ange ». Justyna veut crier mais n’y parvient pas. Elle court rejoindre sa mère qui est déjà repartie et qui n’a rien vu. Elle lui dit : « Il y a une belle dame, elle a de longs cheveux très beaux qui lui tombent sur l’épaule ; elle est assise sur un trône d’or. »
Alerté par les cris de Justyna, le curé les rejoint. Mais ni lui ni sa mère ne voient quoi que ce soit. L’hypothèse d’une hallucination collective doit être abandonnée : seules les deux fillettes (Barbara sera la seconde voyante dès le lendemain) verront la Vierge. Le lendemain, 28 juin, Justyna récite le chapelet avec ses camarades à quelques mètres de l’érable où la Dame était apparue la veille. Soudain, la Vierge se montre de nouveau, selon le même scénario : lumière blanche puis « matérialisation » corporelle. Cette fois, une de ses amies, Barbara Samulowska, 12 ans, la voit aussi : entourée « d’anges » et ceinte d’une « couronne ».
En à peine trois mois, on dénombre pas moins de 160 apparitions. Le 3 juillet, l’apparition dit aux fillettes : « Je serai avec vous encore deux mois ». La dernière apparition date en effet du 16 septembre 1877.
Les messages recueillis sont peu nombreux et parfaitement conformes à la foi de l’Église : ils demandent la récitation quotidienne du chapelet (message du 30 juin), prière et conversion. Aucune nouveauté théologique ou liturgique n’est évoquée. L’apparition s’exprime non pas en allemand ni dans un polonais pur, académique, mais dans le patois régional fort différent des autres dialectes polonais.
À l’instar des autres grandes mariophanies, l’identité de l’apparition n’est pas connue immédiatement. Il faut attendre le 1er juillet pour que la Dame révèle son nom : « la Très sainte Vierge Immaculée ». Ce vocable fait évidemment écho au dogme de l’Immaculée Conception proclamée par l’Église en 1854.
L’apparition invite les fidèles de la région à prier toujours davantage pour que cessent les persécutions prussiennes contre les catholiques. Ce qui est extraordinaire tient en ceci : malgré les intimidations des Prussiens (entraves répétées du pèlerinage, emprisonnement du curé de Gietrzwald pendant cinq jours, éloignement des voyantes du village, interdictions de se réunir sur le lieu des apparitions, etc.), jamais le flot des fidèles ne sera stoppé et jamais les deux fillettes ne raconteront quelque chose de différent de leur premier récit du 28 juin 1877.
Le 6 juillet, la Vierge demande « un reposoir sous l’arbre [où elle se manifeste], avec une statue de l’Immaculée Conception, avec des tissus posés au pied du reposoir », de manière à ce qu’ils soient bénis par elle et distribués aux malades qui en feraient la demande : dans les jours qui suivent, des guérisons inexpliquées sont rapportées ; leur nombre augmente au fil des semaines. Des rapports médicaux confirment ces prodiges.
Le 6 août 1877, Mgr Filip Krementz, évêque de Warmie, diligente une enquête ; plusieurs prêtres interrogent Justyna et Barbara, ainsi que des habitants et le curé. Leur rapport de 47 pages, très favorable, est transmis à l’évêque qui se rend lui-même sur place. Il rencontre les deux voyantes qu’il interroge ensemble et séparément. Sur son ordre, trois médecins (deux catholiques et un protestant) examinent les fillettes et rapportent un fait qui dément toute possibilité de fraude ou de tromperie : lors des apparitions, la physionomie des fillettes change, ainsi que plusieurs indicateurs physiologiques – accélération du pouls, refroidissement des extrémités du corps, fixité totale du regard… Ces paramètres redeviennent immédiatement normaux quand cesse l’expérience visionnaire.
Les trois médecins enquêteurs jugent les deux fillettes « discrètes, simples, naturelles et étrangères à toute forme de duplicité ». L’avenir vient confirmer leur jugement : elles deviennent toutes deux Filles de la Charité de saint Vincent de Paul. Justyna quitte sa congrégation pour épouser un Français à Paris en 1899, mais elle vivra en chrétienne tout son parcours humain. Barbara reste religieuse et est envoyée comme missionnaire au Guatemala où elle meurt en 1950 en odeur de sainteté. Une cause de béatification est ouverte en 1950.
Le 8 septembre, près de 50 000 personnes (dont des Lituaniens et des Allemands) se rendent sur place ; ce jour-là, l’apparition désigne une source près de l’érable. Des personnes souffrant de pathologies diverses recouvrent la santé après y avoir puisé un peu d’eau, comme le constatent des médecins de la région. Pas moins de 15 000 personnes viennent au village le 16 septembre, jour de la dernière apparition. Bismarck déclare : « Nous ne pouvons tolérer aucun Lourdes dans l’Empire. » Il échoue à Gietrzwald comme il avait échoué à Marpingen (Allemagne, Sarre) en juillet 1876, après que la Vierge y est apparue.
Mgr Krementz laisse le culte se développer, autorise les pèlerinages et la diffusion des messages, sans intervenir ni statuer quant à l’origine surnaturelle des apparitions, une attitude commandée par la prudence en ces temps de persécutions : les Prussiens auraient inévitablement pris une telle reconnaissance pour un affront.
Pendant un siècle, le pèlerinage continue et gagne en renommée, malgré les vicissitudes de l’histoire. Le 10 septembre 1967, tandis que la Pologne est en plein régime communiste, les cardinaux Stefan Wyszynski (primat de Pologne) et Karol Wojtyla (archevêque de Cracovie, futur pape Jean-Paul II) couronnent l’image de Notre-Dame de Gietrzwald. Le 2 juillet 1970, le pape Paul VI érige le sanctuaire marial fondé sur le lieu des apparitions au rang de basilique mineure.
Enfin, le 11 septembre 1977, dans le cadre des célébrations du centenaire des apparitions, présidées par Mgr Karol Wojtyla, et en présence du cardinal Wyszynski, l’évêque de Warmie, Mgr Jozef Drzazga, déclare par décret les apparitions de 1877 « authentiques et dignes de foi ».
Dans les années 2000, le village accueille un million de pèlerins par an. En 2017, ce chiffre est identique.
Patrick Sbalchiero
Au-delà des raisons d'y croire :
Gietrzwald est un lieu de paix et d’intériorité qui n’a jamais disparu, y compris dans les pires moments de l’histoire de la Pologne.
Aller plus loin :
René Laurentin et Patrick Sbalchiero, « Gietrzwald », dans Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie, Paris, Fayard, 2007, p. 389-390.